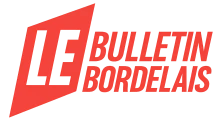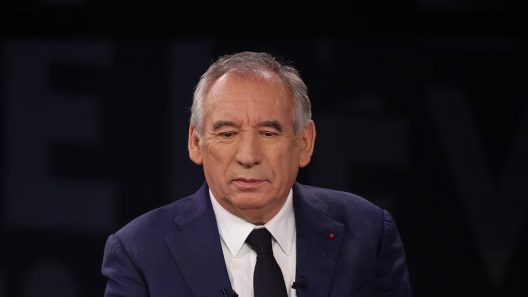Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, la réforme du Revenu de Solidarité Active (RSA) est généralisée à l’ensemble du territoire français, touchant ainsi 1,2 million de bénéficiaires.
Cette transformation vise à renforcer l’insertion professionnelle des allocataires en conditionnant le versement de l’allocation à la réalisation d’au moins 15 heures d’activité hebdomadaires.
L’objectif principal de cette réforme est d’atteindre le plein emploi en France, avec un taux de chômage ciblé à 5 % d’ici 2027. En imposant une obligation d’activité, le gouvernement entend encourager les bénéficiaires du RSA à renouer avec le marché du travail, tout en leur offrant un accompagnement renforcé. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de réduire la dépendance aux aides sociales et de favoriser l’autonomie financière des individus.
Mise en œuvre et premiers résultats
Avant sa généralisation, la réforme a été expérimentée dans 47 départements, impliquant environ 55 000 allocataires. Les premiers bilans indiquent que 42 % des participants ont retrouvé une activité professionnelle au bout de six mois, un chiffre qui atteint 54 % après douze mois. Ces résultats suggèrent une efficacité notable de l’accompagnement proposé, bien que des défis subsistent, notamment en matière de mobilité et de formation des bénéficiaires.
Yanis, 29 ans, bénéficiaire du RSA dans la métropole de Lyon, partage son expérience :
« Grâce à l’accompagnement personnalisé, j’ai pu identifier mes compétences et suivre une formation adaptée. Aujourd’hui, je suis en contrat à durée déterminée dans une entreprise locale. »
Ce témoignage illustre l’impact positif que peut avoir un soutien ciblé sur le parcours professionnel des allocataires.
Malgré des résultats encourageants, la réforme suscite des inquiétudes. Des associations comme le Secours Catholique et ATD Quart Monde ont observé une augmentation du non-recours au RSA de 10,8 % dans les départements expérimentateurs, contre une diminution de 0,8 % ailleurs. Elles alertent sur le risque d’exclusion de certains publics vulnérables, notamment ceux confrontés à des obstacles sociaux majeurs.

Comparaisons européennes : une mesure singulière ?
En Europe, plusieurs pays ont mis en place des dispositifs d’accompagnement pour les chômeurs, mais avec des variations notables dans leur fonctionnement et leur succès.
Royaume-Uni : le modèle du Universal Credit
Au Royaume-Uni, l’Universal Credit combine plusieurs aides sociales, y compris les allocations chômage, en une seule prestation. Le système encourage activement la recherche d’emploi en imposant des “conditionalités”, telles que l’obligation de prouver des démarches de recherche d’emploi régulières. Ce modèle a permis de réduire le taux de chômage à environ 4 %, mais il a aussi été critiqué pour son approche rigide et les sanctions fréquentes appliquées aux bénéficiaires non conformes.
Allemagne : l’exemple de Hartz IV
En Allemagne, le système Hartz IV impose également des obligations aux bénéficiaires, notamment en termes de disponibilité pour l’emploi et de participation à des formations. Ce dispositif, souvent cité comme un exemple de succès, a contribué à un taux de chômage historiquement bas (3 % en 2023), mais il a aussi fait l’objet de controverses pour ses exigences strictes et la précarisation de certains emplois.
Danemark et Suède : l’accent sur la formation
Les pays scandinaves adoptent une approche plus inclusive. Au Danemark, par exemple, les bénéficiaires de l’aide sociale doivent suivre des programmes de formation et de reconversion professionnelle intensifs. Cette méthode, connue sous le nom de “flexicurité”, associe flexibilité du marché du travail et sécurité sociale renforcée. Ces dispositifs ont montré une efficacité certaine, avec des taux de chômage parmi les plus bas d’Europe (2,7 % au Danemark en 2023).