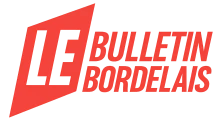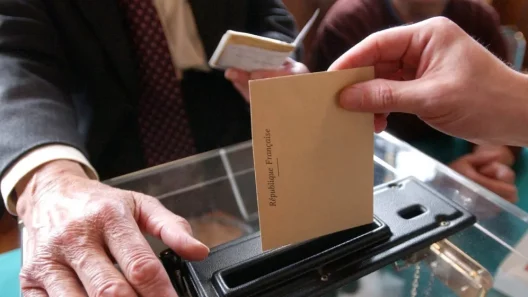À la tribune des Nations unies, Donald Trump a surpris une nouvelle fois par un discours à la tonalité changeante, mêlant fermeté affichée et ambiguïtés persistantes. Son intervention a ravivé les interrogations sur la véritable orientation de Washington dans le conflit russo-ukrainien.
L’ancien magnat a d’abord évoqué la possibilité d’un retour aux frontières d’avant-guerre, misant sur l’affaiblissement économique de Moscou. Il a même laissé entendre que l’Ukraine pouvait reprendre l’intégralité de ses territoires occupés. Cette position tranche avec les concessions accordées quelques mois plus tôt par son administration, lorsqu’elle semblait prête à accepter les annexions revendiquées par le Kremlin.
Dans le même temps, Trump a exhorté les pays européens à cesser tout achat de pétrole russe et dénoncé le rôle de Pékin et de New Delhi dans le financement indirect de l’effort de guerre de Moscou. Mais, fidèle à son habitude, il n’a pas clarifié quelle ligne exacte suivraient les États-Unis : maintien des sanctions, soutien militaire accru à Kiev ou rôle de médiateur. L’incertitude demeure, d’autant que son secrétaire à la Défense avait jusque-là adopté une position beaucoup plus conciliante face aux exigences russes.
Le président américain a également durci le ton sur les violations de l’espace aérien de l’Otan, affirmant que les alliés devraient neutraliser tout appareil russe s’y aventurant. Une sortie en contradiction avec ses précédents appels à éviter toute escalade directe avec Moscou. Ce jeu de balancier, entre gestes d’ouverture et menaces martiales, illustre les hésitations d’une présidence qui peine à stabiliser sa stratégie face à Vladimir Poutine.
En privé comme en public, Trump reconnaît désormais que sa proximité passée avec le maître du Kremlin n’a pas produit les résultats espérés. Il se laisse quelques semaines pour trancher sur la poursuite ou non de sa confiance envers lui. Un délai qui pourrait, une fois encore, déboucher sur un revirement spectaculaire.